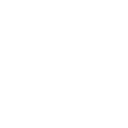Quand Jacky Schwartzmann n’écrit pas des livres, satires sociales impeccables,
il joue au foot en salle à Besançon dans une équipe qui s’appelle le FC Trincamp
(lui aurait préféré les Fils de Buts mais ses collègues de ballon n’ont pas voulu).
Son Club de coeur ? Les Bleus. Il a accepté de répondre aux questions de Virage.
Pour la beauté du geste…

Jacky, quelle image avez-vous du PSG en 2025 ?
Jacky Schwartzmann : déjà, je n’ai aucune animosité envers le PSG. Je me souviens encore de Borelli qui embrasse la pelouse du Parc. Je me souviens de Rai, de Pauleta. Je n’ai aucune haine anti-parisienne. Mon rêve, c’est de vivre à Paris. Et à chaque fois que j’y suis, quand je respire le métro, j’ai l’impression que je suis dans la forêt (rires). Non mais c’est vrai en plus ! J’adore Paris ! Moi, mon vrai fanatisme, c’est l’équipe de France. Côté clubs, j’aime bien Lyon, j’ai vécu 15 ans là-bas mais je suis à fond Paris en Ligue des Champions. Et l’équipe actuelle me plaît vachement. J’adore Barcola, il a eu une petite chute de tension mais là, il revient fort.
Dans votre essai Allez vous faire foot (aux Éditions du Petit Écart), votre premier chapitre s’intitule “Aux chiottes l’arbitre” et raconte comment vous êtes entré en foot avec le France-Allemagne de 1982. Notre génération est tombée amoureuse du foot avec une défaite cruelle, une tragédie… Nous aurions dû fuir et nous sommes restés. Du masochisme… comment l’expliquez-vous ?
Jacky Schwartzmann : peut-être parce que tu te dis que c’est impossible qu’on revive ça… que le coup d’après, ça sera bon. Mais moi, mon plus gros drame, c’est 1986. Le France-Allemagne de 1986. J’ai 14 ans. Je comprends bien les enjeux. Et on perd 2-0 et il n’y a rien à dire. À l’époque, je voulais cracher à la face de Platini. C’était notre revanche et vous faites ça les gars ! On arrive cuits après les prolongations contre le Brésil. Dur. T’as gagné l’Euro, tu dois taper l’Allemagne mais non. 2-0 et pas de scénario dingue comme en 1982. Une défaite logique. Sans rebondissement ni rien. Je l’ai encore en travers de la gorge… avant 1982, ma seule image de foot, je crois que ce sont les papelitos qui volent dans le stade en Argentine en 1978.
Quand vous parlez de foot, vous évoquez régulièrement un virus ?
Jacky Schwartzmann : c’est complètement ça.
Vous êtes papa. Vous avez transmis la chose à votre progéniture ?
Jacky Schwartzmann : évidemment (rires) ! Le 1982 de ma fille aînée, c’est le France-Argentine de 2022. Elle avait un petit copain à l’époque, elle était en sixième. Simon, un petit gars avec la mèche blonde sur le côté, tout gentil, qui est venu chez nous assister à la finale. Moi, je portais le maillot de l’équipe de France. D’entrée, je lui dis : “je te préviens Simon, tu me connais, tu m’as déjà vu mais en fait, là, tu vas voir quelqu’un d’autre, je préfère te prévenir ! Faut pas que tu flippes (rires).” J’ai passé mon match debout à hurler derrière le canapé, je criais des insultes toutes les 30 secondes (rires). Moi, devant un match à enjeu, je deviens fou. Pour ma femme, c’est devenu une blague de me filmer dans ces moments-là.
Avant de devenir supporter, avez-vous joué au foot ?
Jacky Schwartzmann : je jouais surtout avec mes potes dans la rue. Je crois que mon plus vieux souvenir d’enfance, c’est un crochet. Un crochet droit. On était dans la cité avec mon frère… On vivait au rez-de-chaussée et devant nos fenêtres, il y avait un terrain de foot. Mon frangin jouait tout le temps et une fois, j’ai pu jouer avec eux (ils étaient plus âgés). Je devais avoir 5 ans. Ça faisait chier mon frère. Mais j’ai pu jouer. Et là, je fais ce crochet du droit à un grand. Je l’ai dribblé. Je n’avais pas été bon ce jour-là mais je me souviens m’être dit : “je veux faire ça toute ma vie !”. Après, mes parents ont divorcé, je suis parti vivre chez mon beau-père qui est chercheur en médecine, je suis passé chez les bourgeois en ville. Et pour ma mère, le foot, c’était quand même un truc de beaufs. Un peu plus tard, on est allé vivre à la campagne et j’ai joué avec un pote deux saisons en minime. J’étais ailier droit. Et pendant deux ans, on a tout défoncé. J’étais meilleur buteur. Mon premier match, j’ai mis 5 buts. J’étais comme un fou. Pourquoi j’ai arrêté ? Parce que la mobylette, la cigarette, la poésie (rires)… Quand on est passé au foot à 11, j’étais moins à l’aise sur le grand terrain. Encore aujourd’hui. Sur un grand terrain, je suis un peu perdu. Je suis nettement meilleur en futsal. Je me suis remis à jouer vers 25 ans avec mon grand frère, pendant plusieurs saisons. On était en dernière division. Tu jouais avec des bouchers. Mais j’adorais ça. C’était trop cool. Je me souviens, on avait un arrière central, c’était un tueur avec une tête de tueur (rires). Un grand costaud. Quand tu jouais avec lui, c’était top. Ouais, c’était notre Carlos Mozer. Quand je prenais des coups, j’allais le voir pour le chauffer. Et il s’en occupait (rires).
On sait que vous aimez accrocher dans votre bureau des photos de gens qui vous inspirent. Des chanteurs, des peintres… Et des footballeurs ?
Jacky Schwartzmann : non. Enfin, là maintenant, j’ai une photo de Zidane. C’est un souvenir. À Lyon, j’ai vécu en coloc avec un pote. Des trentenaires célibataires. Je te fais pas de dessin… Et j’avais mis une photo de Zidane face à moi pour voir tous les jours l’image de quelqu’un qui avait réussi. Le truc psychologique à deux balles (rires). À l’époque, je bataillais pour devenir écrivain. Et mon pote lui avait mis du rouge à lèvres avec un feutre rouge, comme un vieux travelo. Et donc, je l’ai gardée. J’ai toujours cette image de Zidane en travelo dans mon bureau.
Vous écrivez que le foot, le temps d’un match, c’est une histoire d’amour et de haine. Une sorte de guerre sans cadavres en somme. Pour de faux.
Jacky Schwartzmann : c’est évidemment une catharsis. Encore plus forte qu’au théâtre ou au cinéma. Tu vas voir des émotions mises en scène devant toi. Ça peut te faire pleurer, rire mais le foot, c’est d’autant plus fort que tu es impliqué. Tu es supporter. Tu ne viens pas juste assister, tu participes. Il n’y a pas de supporters au théâtre ou au cinéma. Pas de ola (rires). Juste des spectateurs. Le supporter, lui, peut devenir dingue. Il n’y a que le foot pour te donner ce genre d’émotions. Il n’y a rien de plus intense qu’un match de foot.

Page 16 de votre ouvrage, vous évoquez la banderole sur les Ch’tis de 2008 déployée par les supporters parisiens au Stade de France le soir de PSG-Lens. La vanne dans le football, c’est primordial non ?
Jacky Schwartzmann : ce que les gens ne comprennent pas, c’est que ce sont juste des vannes en fait. Ceux qui ont porté plainte suite à cette banderole sont des cons. Pour moi, c’était la meilleure banderole de tous les temps. C’est un folklore. Tu te chambres avant, pendant et après. Et puis, ta banderole, elle peut te revenir dans la gueule, c’est le jeu. Je me souviens avoir spontanément éclaté de rire en la voyant. La vanne, c’est souvent nul et con mais ça me fait marrer. Et il n’y a pas mort d’homme, faut se détendre…
En lisant votre livre, on peut parfois avoir l’impression que vous regrettez de ne pas être devenu supporter d’un club. On se trompe ?
Jacky Schwartzmann : oui, c’est vrai, si j’avais grandi dans une ville où ça avait été possible, effectivement, c’est quelque chose que j’aurais adoré. Moi, je suis de Besançon au départ. J’aurais pu choisir Sochaux mais j’aurais dû aller vivre à Montbéliard (rires). Si j’étais né à Marseille, Lyon ou Paris, je serais fou du club local, c’est certain.
Si vous deviez ne conserver que trois matches dans votre mémoire ?
Jacky Schwartzmann : c’est dur ça… Il y aurait forcément le France-Brésil de 2006 et le festival Zidane, même s’il n’y a qu’un but. Aussi le France-Argentine de 2018 et puis peut-être le 5-5 de fou entre l’OL et l’OM… non, j’suis con, je ne peux pas oublier le France-Brésil de 1998 ! C’est trop difficile comme question.
Si vous deviez écrire une fiction sur le foot, ça donnerait quoi ?
Jacky Schwartzmann : je n’y ai bizarrement jamais pensé. J’ai lu football Factory de John King. J’avais bien aimé cet angle supporters anglais qui se donnent rendez-vous sur des parkings pour se foutre sur la gueule (rires). Si je devais écrire sur le foot, j’essayerais de faire un petit pas de côté. Mon héros ne serait pas un joueur ou un coach. Mais plutôt le mec qui tient la buvette… ou Bernard Tapie (rires). Ça serait un truc plutôt critique sociale, comme je fais d’habitude…
Ça vous est déjà arrivé de sacrifier l’écriture pour le foot ?
Jacky Schwartzmann : oui ! Si c’est en période de Coupe du Monde, je sacrifie tout ! Bien sûr ! J’étais à un salon du livre pour le France-Argentine, Les Pontons Flingueurs à Annecy. Le concept, c’est de mettre tous les auteurs dans un bateau qui, sur le lac d’Annecy, va de ponton en ponton à la rencontre des gens. Il y a plusieurs arrêts dans la journée, le public vient dans le bateau. Les auteurs font des débats, échangent… C’est vraiment sympa. Avant de prendre le bateau, je demande à l’organisateur s’il y a une télé. Il me répond que non. Je lui dis que je ne monte pas. Je m’en fous, je ne monte pas ! “Tu ne peux pas faire ça Jacky, il y a le public !”. “Il n’y a pas de public qui tienne, je ne monte pas sur le bateau !”. Je les ai rendus fous. Et du coup, il a passé des coups de fil et au moment du match, on s’est arrêté dans un camping avec un écran géant qui diffusait la rencontre. Je me souviens aussi qu’un jour, on va en famille dans un parc pour enfants avec trampolines dans tous les sens. En arrivant au resto du parc, je capte qu’il y avait un match super important de Paris en Ligue des Champions. J’avais complètement zappé. Derrière ma femme, il y avait un écran avec le match et sans le son. C’était rigolo : j’ai passé tout le repas à parler avec ma femme avec les yeux en l’air (rires). Elle m’a vite calculé.

Dans votre libre toujours, vous dîtes que la main de Dieu de Maradona reste le plus beau geste de l’histoire du foot. Vous parlez même de quintessence du foot ?
Jacky Schwartzmann : la roublardise absolue ! Le vice de la rue. Maradona avait eu cette phrase géniale quelques années après. Il disait qu’il avait eu l’impression de voler le portefeuille d’un Anglais dans sa poche. Et de battre les Anglais à leur sport, qu’ils ont amené en Argentine, juste après la guerre des Malouines, c’est juste incroyable. Ce même but marqué par un autre joueur, je pourrais crier au scandale. Mais c’est Maradona ! Il met dans le même match le plus beau but techniquement parlant où il dribble toute l’équipe et cette main impossible ! Maradona a même presque plus de vice dans sa célébration que dans la main elle-même. Formidable ! Les puristes, les intellectuels du foot te parleront d’une horreur mais on les emmerde (rires).
Selon vous, et malgré ses dérives mercantiles de plus en plus prononcées, vous pensez que le foot reste l’une des dernières expressions véritablement populaires ?
Jacky Schwartzmann : dans le foot, tu ne peux pas tricher. Il n’y a pas de fils de par exemple. Si tu es une burne, tu ne joues pas, fils de Zidane ou pas fils de Zidane… le foot, ce sera toujours des gamins qui viennent du milieu populaire, des gamins de la rue. Après, le foot qui te coûte 200 balles pour aller voir un match… Ou 80 balles pour pouvoir au moins le voir à la télé… ça, je suis moins fan.
Dans votre livre Pyongyang 1071 (Paulsen) racontant ce marathon auquel vous avez participé en Corée du Nord, il y a cette anecdote sur Éric Di Meco. Racontez-nous.
Jacky Schwartzmann : je m’étais entraîné pour boucler ce marathon en moins de 4 heures. Il fallait pour ça que je fasse le kilomètres en 5 minutes 30. Avec ta montre, tu vois ta vitesse en direct pendant la course. Je suis parti trop vite, comme un couillon de 12 ans qui a des nouvelles baskets. J’étais évidemment en surrégime. Au kilomètre 21, je me suis dit que ça n’allait pas le faire. Psychologiquement, c’était dur à encaisser. Au kilomètre 32, je me suis arrêté. Plus de jus, plus rien. J’étais mort. Et c’est là que j’ai entendu la voix de Di Meco. C’est moi qui me parlais bien sûr, je n’étais pas en plein trip hein. Je me suis auto-parlé avec la voix de Di Meco. Il m’a dit (ce n’est pas comme ça dans le livre, trop vulgaire) : “tu vas te bouger la chat***, t’es français, t’as pas le droit d’abandonner dans ce pays d’enc*** !”. Si Di Meco te dit ça, avec sa grosse voix, quand tu fais comme moi 1m 65, tu l’écoutes (rires) ! Et j’ai fini le marathon, grâce à Éric. Et j’aimerais trop le rencontrer pour lui raconter et lui dire : “merci. Pas pour la finale de 1993, j’en ai rien à foutre mais pour mon marathon de 2021…”.
Photo © The*Glint